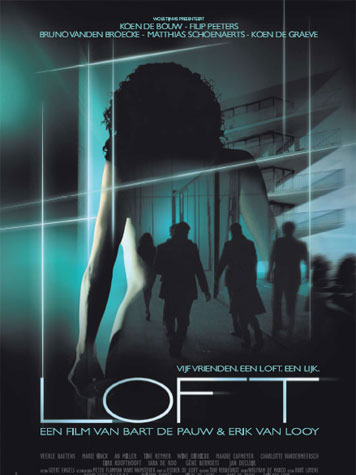Privilège de l'âge? Déformation due aux années qui passent? Toujours est-il qu'en vieillissant, la contemplation esthétique d'une œuvre d'art s'avère moins fondamentale que l'envie de percer le sens symbolique, la signification politique, la portée sociale de cette œuvre. Non qu'il y ait de la lassitude à laisser son œil se perdre dans l'univers infini des formes, cette jouissance reste non seulement un privilège mais une nécessité pour tout être humain, mais force est de reconnaître que cette part de plaisir s'avère purement subjective et qu’il faut manier nos enthousiasmes avec une certaine prudence parce que notre sens du beau est modelé sur des canons dont la portée est relative et donc éphémère. Car notre goût n'est jamais rien d'autre que la combinaison indicible entre une expérience personnelle, plus ou moins forte selon les cas, et les normes capricieuses et forcément fluctuantes de ce qu'on nomme "l'air du temps". Or, ces normes esthétiques que nous pensons immuables évoluent, s’aiguisent, se corrompent, de sorte que le rapport que nous entretenons avec certains chefs-d'œuvre (comme avec les créations de "petits maîtres") peut fluctuer de la même manière, par exemple, que nos sentiments amoureux. Lorsque Nietzsche proclame son adoration juvénile de la musique wagnérienne puis, plus tard sa haine pour cette même musique, à quel moment est-il le plus proche de la vérité ? Dans les deux cas, n’est-il pas d’une rare honnêteté avec lui-même ? Le caractère absurde dans lequel toute tentative de réponse nous plongerait démontre que la beauté n'est pas normative et que, comme l’avait perçu Kant, aucun concept ne permet d'en définir les contours, quand bien même le Beau serait une quête universelle pour tout un chacun. Face à nos goûts, il apparaît urgent de ne pas se vautrer dans l’esprit de système ou dans le dogmatisme fanatique des pronostics éphémères puisque nous serons les premiers à ne plus être ultérieurement en accord total avec nos classifications.
Privilège de l'âge? Déformation due aux années qui passent? Toujours est-il qu'en vieillissant, la contemplation esthétique d'une œuvre d'art s'avère moins fondamentale que l'envie de percer le sens symbolique, la signification politique, la portée sociale de cette œuvre. Non qu'il y ait de la lassitude à laisser son œil se perdre dans l'univers infini des formes, cette jouissance reste non seulement un privilège mais une nécessité pour tout être humain, mais force est de reconnaître que cette part de plaisir s'avère purement subjective et qu’il faut manier nos enthousiasmes avec une certaine prudence parce que notre sens du beau est modelé sur des canons dont la portée est relative et donc éphémère. Car notre goût n'est jamais rien d'autre que la combinaison indicible entre une expérience personnelle, plus ou moins forte selon les cas, et les normes capricieuses et forcément fluctuantes de ce qu'on nomme "l'air du temps". Or, ces normes esthétiques que nous pensons immuables évoluent, s’aiguisent, se corrompent, de sorte que le rapport que nous entretenons avec certains chefs-d'œuvre (comme avec les créations de "petits maîtres") peut fluctuer de la même manière, par exemple, que nos sentiments amoureux. Lorsque Nietzsche proclame son adoration juvénile de la musique wagnérienne puis, plus tard sa haine pour cette même musique, à quel moment est-il le plus proche de la vérité ? Dans les deux cas, n’est-il pas d’une rare honnêteté avec lui-même ? Le caractère absurde dans lequel toute tentative de réponse nous plongerait démontre que la beauté n'est pas normative et que, comme l’avait perçu Kant, aucun concept ne permet d'en définir les contours, quand bien même le Beau serait une quête universelle pour tout un chacun. Face à nos goûts, il apparaît urgent de ne pas se vautrer dans l’esprit de système ou dans le dogmatisme fanatique des pronostics éphémères puisque nous serons les premiers à ne plus être ultérieurement en accord total avec nos classifications.S'il est hors de question de se priver, on l'aura compris, du plaisir certes précaire qu’occasionne une œuvre d’art, son décryptage symbolique n'en reste pas moins fondamental pour l'apprécier pleinement.
Un exemple : lorsqu’on se rend à Venise, on est frappé par les proportions et le mélange de styles de l’imposante Basilique San Marco. Une fois que le regard s’est habitué à distinguer les différents langages de l’œuvre (les apports byzantins, romans, gothiques) à en mémoriser les moindres contours et que notre opinion esthétique a pris forme, il y a un plaisir tout aussi subtil à comprendre par exemple le sens que cette architecture revêt aux yeux des commanditaires et de leurs contemporains. Depuis 607, Aquilea et Grado, deux villes dans l’actuelle province du Frioul-Vénétie julienne, se disputent le contrôle de Venise, sous dépendance byzantine. En 827, le synode de Mantoue donne gain de cause à Aquilea. Afin d'assurer son indépendance, le doge Giustiniano Partecipazo crée en 828, soit à un an à peine après le synode, le mythe de la translation des restes de saint Marc en prétendant que deux marchands de Torcello ont ramené d’Alexandrie le saint caché dans de la viande de porc. Comme possesseur du corps, le doge peut ainsi aisément revendiquer une indépendance politique face à Byzance (mais aussi à Rome) et clamer la destinée de droit divin de sa cité ; la translation devient une représentation allégorique de l'unité politique de la lagune autour de sa personne. En tant qu'administrateur laïc des restes de San Marco, le doge doit pourvoir à la construction d’une nouvelle église. Les choix esthétiques répondent à leur tour à des impératifs bien ciblés : Giustiniano Partecipazo conçoit sa basilique sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem, choix qui n’est pas anodin puisque le doge entend faire symboliquement de Venise une nouvelle Jérusalem. La basilique prend d’ailleurs une importance toute particulière à Pâques lorsque le doge et ses magistrats, reconstituent devant San Marco une allégorie de l'entrée du Christ à Jérusalem, le doge incarnant le Christ. La proximité de la basilique avec le Palais des doges n'est à son tour pas innocente : les doges étant les dépositaires du corps, leur palais est assimilé au Temple de Salomon, voisin du Saint-Sépulcre.
On pourrait développer davantage le propos mais tel n’est pas le but. Cet exemple permet de comprendre que la seule admiration plastique de l’édifice ne suffit pas. Notre plongée dans l’œuvre gagne à être amplifiée, transcendée par la perception de ses enjeux symboliques, même si, et tant pis si cela heurte les puristes, il s’agit de réduire l’art, à l’instar de toute interprétation marxiste, à des considérations qui dépassent le pur plaisir de la ligne esthétique. La démarche a tout de même ses limites. L’étude approfondie d’une œuvre n’a de sens que si, à la base, nous avons une forte empathie avec celle-ci. Sans quoi on en viendrait à se passionner pour des artistes médiocres (Jeff Koons ou Panamarenko) sous prétexte que le fatras littéraire qui accompagne leurs œuvres serait de qualité.
Enfin, quitte à paraître paradoxal, je dois admettre que, à titre personnel, l’art musical est la seule discipline artistique où cette connaissance historique n’apporte pas grand-chose à ma jubilation esthétique. Sans doute parce que l’écoute fait appel à des processus d’assimilation et de perception moins cérébraux et plus spontanés que le regard ? Cela reste encore à prouver…